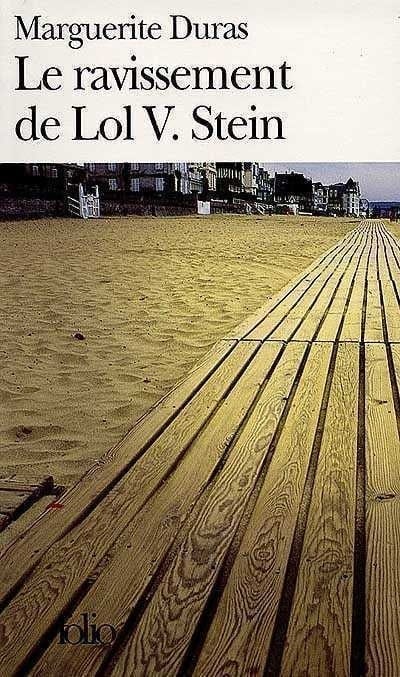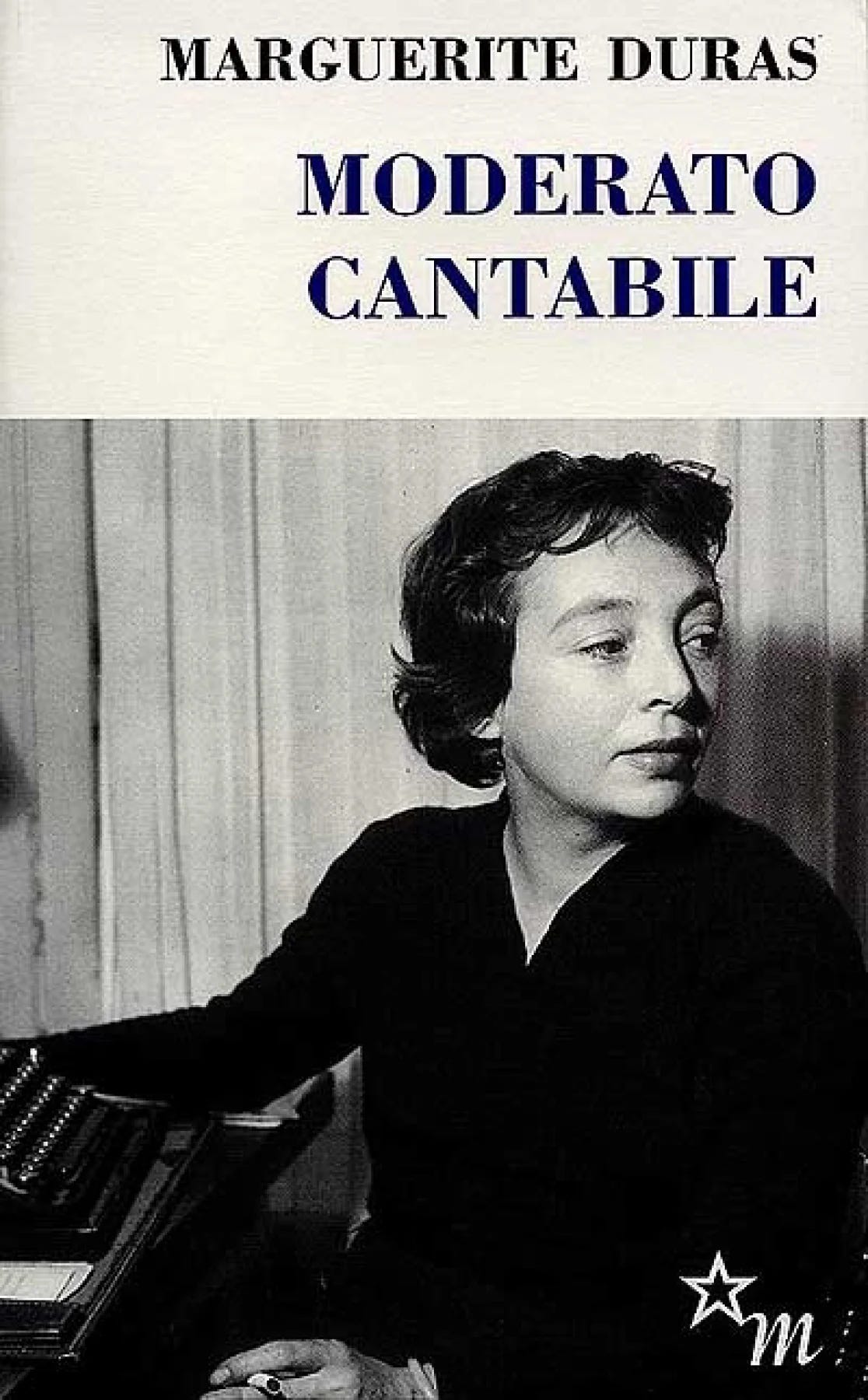Naître d’un baiser, mourir d’un regard
Une lecture croisée de Moderato Cantabile et Le Ravissement de Lol V. Stein
Il y a des livres qui vous emportent loin, très loin, sans prévenir. Moderato Cantabile et Le Ravissement de Lol V. Stein sont de ceux-là. Deux romans durassiens, deux figures en tension entre le regard, le désir et la disparition. Ce qui les relie n’est pas une intrigue, mais une trajectoire : celle d’un déraillement intérieur, d’un basculement vers l’absence ou la transgression. Je vous propose ici mon interprétation croisée de ces deux œuvres. Il y en a d’autres, semblables ou différentes, mais je ne me compare pas : j’exprime ce que j’y ai vu.
Pénétrer le monde de Marguerite Duras, c’est entrer dans l’œuvre d’une autrice majeure du XXe siècle — scénariste, romancière, figure singulière du désir, de l’absence et de l’écriture fragmentaire.
Ses romans déroutent. Et marquent à jamais.
Publié en 1958, Moderato Cantabile est sans doute l’un des romans les plus emblématiques de Marguerite Duras. Minimaliste, troué de silences, il déconcerte, mais marque profondément la littérature de l’après-guerre par son refus de l’intrigue traditionnelle et sa façon de faire vibrer le quotidien. En 1964 paraît Le Ravissement de Lol V. Stein, roman plus opaque, où l’on retrouve cette écriture tendue entre absence et surgissement. Les deux œuvres, rapprochées pour leur radicalité formelle, creusent un même vertige : celui du regard, du désir, et de la dissolution du sujet.
Les deux oeuvres soulignent le mouvement, le basculement intérieur, la dérive vers la marge ou la transgression. Chez Duras, ce ne sont pas les événements qui déplacent le monde, c’est le bouleversement venu de presque rien, ce détail suffisant pour chavirer l’âme dans une émotion silencieuse. Une scène anodine, un cri, un regard suffisent à faire dérailler une existence. Et ce sont ces dérèglements, ces glissements, que Moderato Cantabile et Le Ravissement de Lol V. Stein mettent au centre de l’intrigue : deux figures de femme, deux éclats de subjectivité, deux manières de disparaître ou de se retrouver.
Une mécanique du désir : la répétition
Chez Duras, le désir ne progresse pas : il tourne en rond. Il revient, il rejoue. Un mouvement de balancier, de vague, d’aller-retour entre la scène du crime et le café, entre la maison et le port, entre le souvenir et le fantasme. Anne comme Lol reviennent aux lieux de la fracture, comme pour tenter d’en fixer le sens.
Mais la répétition n’est jamais la copie conforme. Elle mime le même, tout en l’altérant. Un semblable qui varie, un retour jamais tout à fait pareil. Un mouvement qui rejoue, dont chaque réverbération s’intensifie. Un désir qui n’atteint jamais son objet sans le dissoudre. Chaque retour porte l’espérance d’un décalage — un frisson autre, un vertige nouveau, menant à la dissolution. C’est cela, aussi, la structure du ravissement : l’empreinte du déjà-vu, du presque-saisi, du toujours manqué, du semblable qui ne coïncide jamais, mais qui, fatalement, consume l’être.
Voir sans être vue : le pouvoir du regard
Lol ne choisit pas de regarder : elle y est contrainte, comme si elle n’existait plus autrement.
Regarder, pour elle, devient alors une tentative de recoller les morceaux du réel.
Quelque chose s’est brisé en elle lors du bal — ce moment où, sans explication, son fiancé Richardson a quitté la piste avec une autre femme. Elle n’a pas été quittée : elle a été évacuée, sans mot, sans raison. Le désir s’est déplacé sous ses yeux, hors d’elleF. Le désir d’un homme dans lequel elle prenait place s’est soudainement dirigé sur une autre. Et ce déplacement a opéré une violence symbolique majeure. Elle n’a pas crié. Elle n’a pas compris. Mais elle est disparue. Elle est sortie du champ de vision de ce qui la rendait réelle, vivante, de ce qui lui donnait un sens. Ce n’est pas seulement une peine d’amour. C’est une désintégration soudaine du monde dans lequel elle existait. Un effondrement silencieux de la structure même dans laquelle elle pouvait être sujet du désir.
Après cela, Lol ne vit plus à la première personne. Elle n’est plus actrice de sa vie. Elle devient regard. Elle devient seuil. Elle devient absence.
En observant d’autres couples, en rejouant la scène de trahison, elle tente de donner forme à ce qui lui a échappé, comme si, en voyant d’autres vivre ce qu’elle a perdu, elle pouvait s’y inscrire à nouveau.
Elle regarde — derrière les plantes vertes, dans un champ, à travers les gestes d’un couple. Elle tente de recomposer une scène qui l’a détruite, d’y réinscrire sa présence à travers le regard. Mais ce regard ne transforme rien. Il l’ancre dans une boucle. Une répétition stérile du moment de perte.
Lol reste enfermée dans ce passé qui ne cesse de revenir. Elle ne revient pas sur cette scène pour comprendre ou pour se reconstruire : elle y revient parce qu’elle n’est plus nulle part ailleurs. Elle regarde : c’est la seule manière qu’il lui reste d’habiter sa disparition.
Et dans cette errance, ce qu’elle cherche n’est peut-être pas la réintégration au monde, mais la confirmation de sa propre absence. Elle ne veut plus être aimée : elle veut vérifier qu’elle n’existe plus.
Mais, Lol nous apparait par le regard d’un autre. Ce que nous savons d’elle, nous le savons par le narrateur, Jacques Hold, celui qui dit Lol, celui par qui nous la voyons. Ce qu’on sait d’elle, ce qu’on croit comprendre, passe par son récit, traversé de désir et d’interprétations. Mais lui aussi regarde sans jamais vraiment comprendre. Il tente de la saisir par le langage, de la fixer dans le texte, mais elle lui échappe. Comme toujours. Le désir se rejoue, encore. Et encore une fois, il n’atteint son objet que pour l’effacer.
Alors même lorsque Lol regarde, elle est regardée. Même lorsqu’elle échappe, elle est nommée.
Peut-être est-ce cela, au fond, le ravissement : une disparition dans le désir de l’autre et dans ses mots.
Anne : le cri, la faille, le feu
Pour Anne, tout commence par un cri. Un cri brutal, sans visage, entendu au café. Une femme vient d’être assassinée.
Ce cri traverse Anne.
Il ne fait pas que l’effrayer, il réveille quelque chose en elle. Il rappelle un autre cri. Celui, ancien, qu’elle a tu au moment de la naissance de son fils. Ce moment où, en donnant la vie, elle a senti la sienne s’effacer. Son corps ouvert, traversé, puis refermé sur un rôle : mère.
Le désir mis en veille. Le silence imposé. Le geste refoulé.
Depuis, Anne s’est tenue droite. Femme rangée, épouse correcte, mère appliquée.
Mais ce cri fend la surface, la déstabilise. Il ouvre une brèche. Quelque chose se dérègle dans l’ordre silencieux de sa vie. Elle y revient, comme fascinée. Elle écoute Chauvin, ancien employé de son mari, ouvrier désœuvré, bavard et mystérieux, lui raconter l’histoire du meurtre, imaginer les gestes, les regards, le sang. Et elle reste. Et elle revient.
Quelque chose se réveille en elle. Quelque chose s’agite. Entre ces rencontres, elle tente de maintenir son rôle de femme rangée. Elle accompagne son fils à l’école. Elle l’observe, comprend qu’il se dissocie d’elle. Le lien se distend. Son enfant devient étranger. Le cadre maternel se craquelle.
Et dans ce détachement, elle entrevoit une brèche : la possibilité de redevenir autre chose que la mère. Peut-être redevenir femme. Peut-être redevenir corps. Peut-être même corps de désir.
Mais elle ne peut pas simplement revenir en arrière.
Il faut traverser.
Chaque jour, elle revient. Chaque jour, elle boit un peu plus. Le rouge monte, s’impose, dans le tricot de la tenancière, dans le petit bateau. Le désir aussi, rouge aussi.
Un soir, elle reçoit, moment clé.
Le mari est là, des invités aussi. On parle politique, avec distance, avec fatuité. Anne est absente. Elle regarde son fils, elle regarde la pièce, et soudain elle se lève. Elle ne dit rien. Elle quitte la table, sans explication. Et s’en va. Elle n’était déjà plus là.
Elle retourne au café.
Mais cette fois, elle est seule. Elle a laissé son fils derrière. Elle a quitté le cadre.
Elle arrive. Elle s’installe. Elle attend Chauvin. Et là, le désir éclate… un baiser, un seul.
Chauvin dit :
— « Je voudrais que vous soyez morte. » dans une expression brutale d’un désir sans issue, une tentative de dire l’impasse où il se trouve face à Anne.
Son désir n’a plus de voie d’expression. Il n’y aura pas de scène d’amour, pas de transgression concrète. Alors il dit la mort. Non pour tuer, mais parce qu’il n’y a plus rien à quoi se raccrocher.
Et Anne, dans un souffle, répond : « C’est fait. » elle a déjà tout quitté, sa vie de femme bourgeoise, son mari, son fils. Elle signe une renaissance par la perte : elle a traversé le feu du désir.
Lacan a décrit la puissance destructive de la jouissance tel un embrasement : « […] la jouissance […] une fois qu’on y entre, on ne sait pas jusqu’où ça va. […] et ça finit à la flambée de l’essence. Ça, c’est toujours la jouissance1 », à l’image de l’étincelant déclin du jour qui reçoit Anne métamorphosée, libérée, embrasée, lors de son ultime départ du café
« Elle se retrouva face au couchant, ayant traversé le groupe d’hommes se tenant au comptoir, dans la lumière rouge qui marquait le terme de ce jour-là ».
Totalement transformée par cette ultime rencontre avec Chauvin, émancipée du désir de l’autre par sa réalisation, affranchie de son désir même, Anne, seule, se « retrouve » Radieuse telle un soleil qui éclate, en héroïne triomphante d’elle-même et des autres, sa transgression finale ayant pour résultat la reconstruction de sa psyché, enfin hors du rôle féminin traditionnel auquel on l’avait réduite. Elle est grandie, elle est souveraine. Alors que Lol choisit le sommeil, le rêve dans le champ de seigle, protégée de la passion au cœur d’un triangle amoureux qu’elle seule soutient encore, au centre d’une relation entre Hold et Tatiana Karl qu’elle observe sans y appartenir, Anne s’élève, face à la mer, face à la ville, indépendante de son désir, libérée des convenances. Elle a déjà quitté le champ. Il n’y aura pas de retour.
Ces deux trajectoires, l’une suspendue dans l’ombre du passé, l’autre embrasée par une transgression, ne racontent pas seulement une histoire de femme : elles disent quelque chose de l’expérience humaine quand elle se joue dans le regard de l’autre — dans ce lieu instable où se décide notre présence au monde.
Je me reconnais dans les deux. Dans la disparition de Lol, sortie brutalement du regard qui la tenait vivante, cette mort au monde soudaine, disparition subite mais aussi dans la rébellion d’Anne, qui quitte la table, quitte le rôle, quitte le silence. Et je sais que je ne suis pas la seule.
Car ce que racontent Anne et Lol, ce n’est pas une fiction isolée. C’est l’histoire de tant de femmes qui, un jour, ne se retrouvent plus dans le regard qui les a faites. Tant de femmes qui, un jour, osent partir. Ou pas.
Duras, Marguerite, Moderato Cantabile, Paris, Minuit, 1980, 172 p.
Duras, Marguerite, Le ravissement de Lol V. Stein, Paris, Gallimard, 1976, 192 p.
Cité par Yorgos Dimitriadis dans « La jouissance comme concept psychanalytique et son potentiel destructeur sur l’organisme », 2017, hal-01468828f, en ligne, < https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01468828/document >, consulté le 28 novembre 2021, n.p.