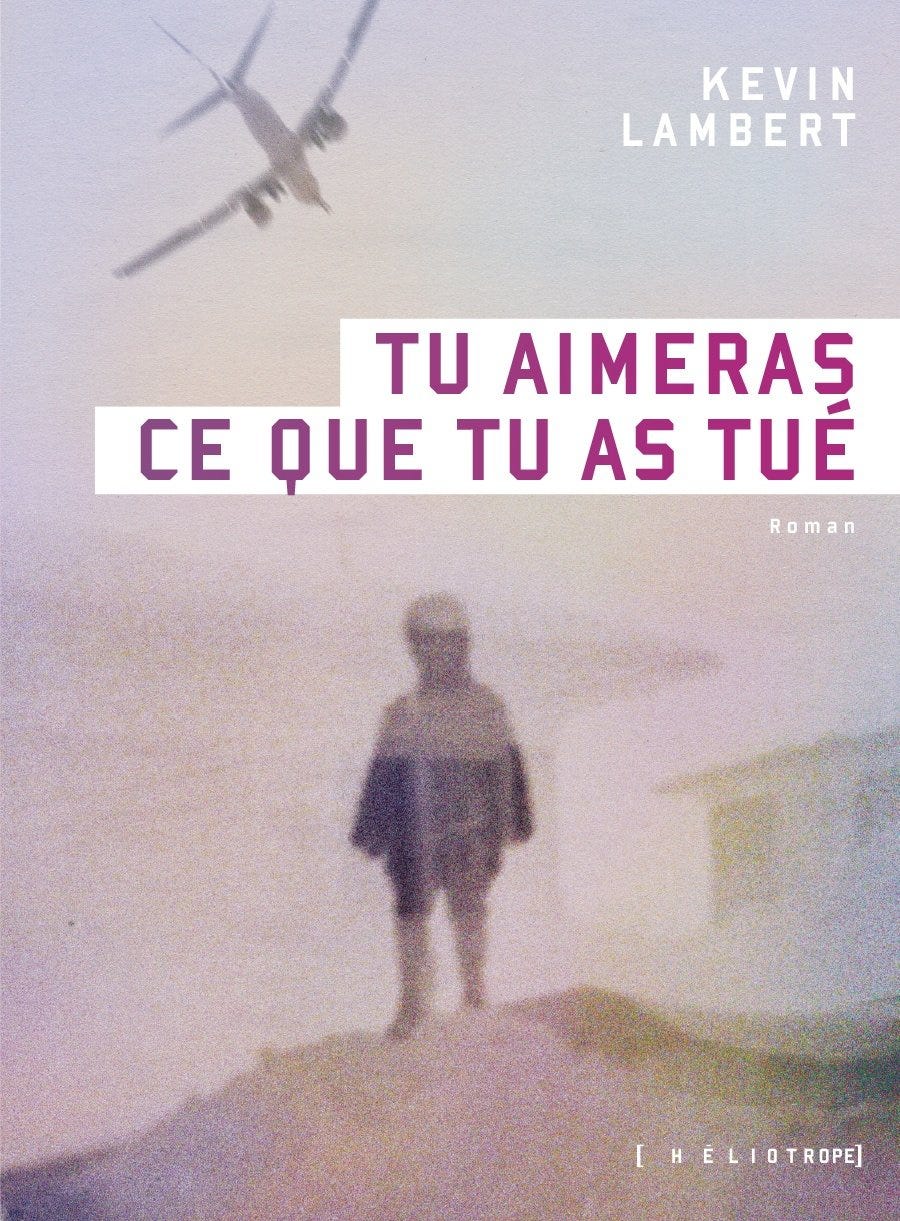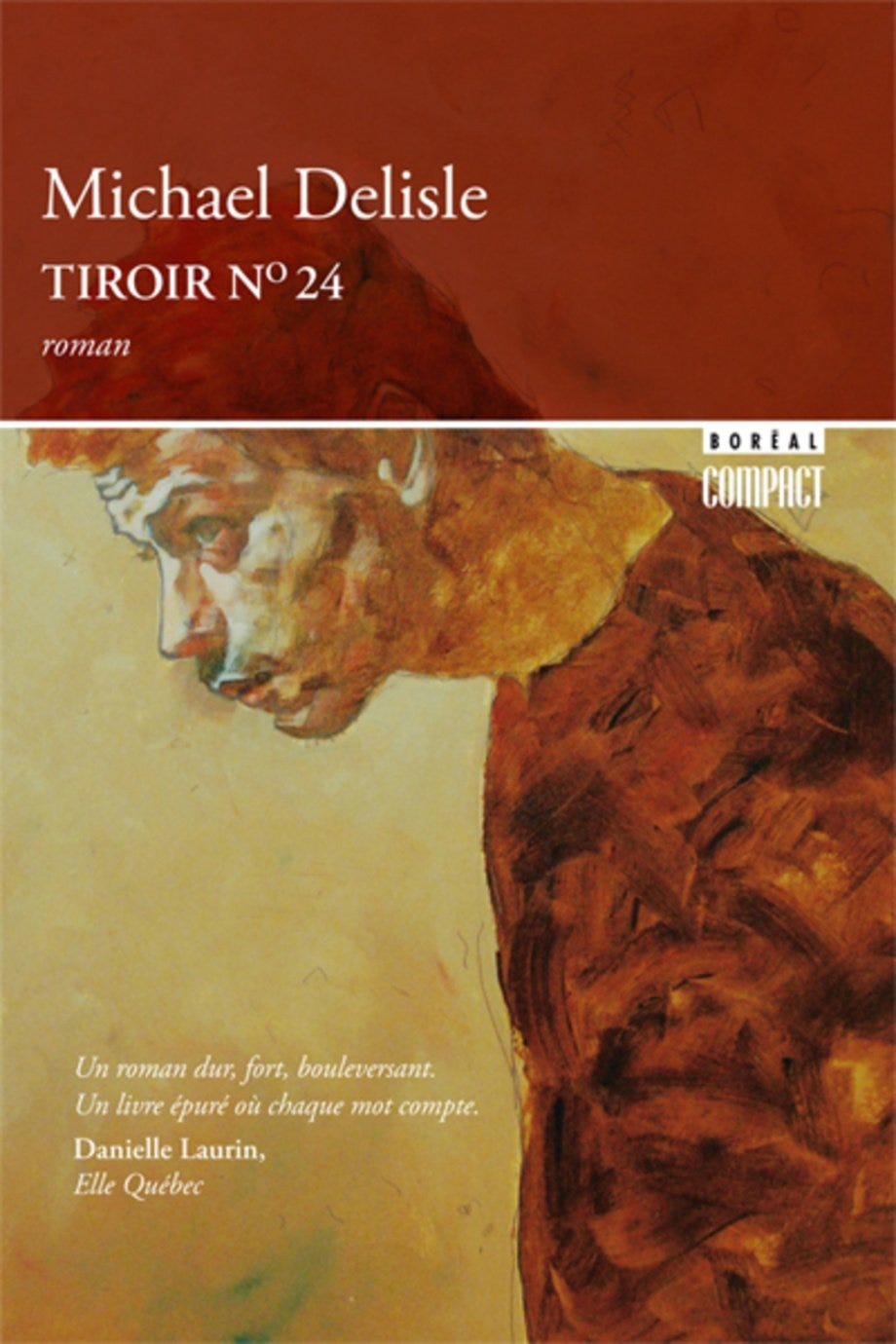Enfants de la marge
Tu aimeras ce que tu as tué et Tiroir 24- Deux romans québécois, deux écritures radicalement opposées, un même verdict : l’exclusion comme destin.
Lire Kev Lambert et Michael Delisle, c’est traverser deux univers très différents en apparence. Pourtant, derrière ces esthétiques contrastées se profile une même problématique : comment écrire quand l’enfance et l’identité ont été façonnées par des normes oppressives, qu’elles soient familiales, religieuses ou sociales ?
Aurélie Pfauwadel, dans un article qui relit Lacan, rappelle une idée décisive :
« Il n’y a pas de normes sexuelles. Il n’y a que des normes sociales ».
Autrement dit, le désir humain ne s’inscrit jamais dans une logique universelle, mais toujours dans des cadres fabriqués, rigides, imposés de l’extérieur. Ces cadres ne font pas que guider les vies ; ils les contraignent, les blessent, les réduisent. C’est à ce constat que ces deux romans nous invitent.
Tu aimeras ce que tu as tué (Kev Lambert, 2017)
Faldistoire grandit à Chicoutimi, ville du Saguenay où règne l’hypocrisie, la religion et l’homophobie. Différent, il incarne tout ce que la communauté rejette. À travers lui, Lambert montre comment une société condamne tout ce qui déborde ses normes : l’homosexualité, l’illégitimité, la marginalité, la désobéissance et même la légèreté. Les enfants morts, condamnés par leurs singularités, reviennent hanter les vivants. Menés par Faldistoire, ils préparent la destruction de Chicoutimi, cette meurtrière de la différence. Le roman, baroque et halluciné, mêle prose flamboyante et apocalypse pour raconter la revanche des exclus.
Tiroir No 24 (Michael Delisle, 2010)
Benoit Murray, enfant roux et chanteur de l’orphelinat, est adopté à l’âge de huit ans par la famille Cyr, boulangers à Montréal. Rebaptisé « le gars des Cyr », il travaille douze ans dans leur commerce, sans jamais être reconnu comme leur vrai fils. Quand la boulangerie ferme, il se fait embaucher par un traiteur voisin, où il vit une passion malheureuse avec son patron, un Belge, marié. Rejeté par les Cyr comme par son amant, il s’enfonce dans la honte jusqu’à mettre le feu au commerce du traiteur, se défigurant dans l’incendie, retour flamboyant à cette chevelure de cuivre qui le marquait déjà comme différent. Delisle raconte ainsi la trajectoire d’un fils jamais attendu, étouffé par la contrainte de porter les valeurs d’autrui, sur fond de mutation du Québec à l’époque de l’Expo 67.
La destruction par les normes
Ces romans, si différents dans leur forme, l’un baroque et carnavalesque, l’autre minimaliste et tendu, montrent une même logique : une communauté se définit toujours par ce qu’elle accepte et par ce qu’elle rejette. La différence devient insupportable dès qu’elle échappe aux valeurs dominantes.
Chez Lambert, cette intolérance amène une révolte qui se change en explosion, une vengeance embrasée qui retourne la condamnation contre la ville. Chez Delisle, elle enferme au contraire dans le silence et la disparition, laissant Benoit se consumer dans un effacement sans retour.
Désirs interdits
Faldistoire n’est pas seulement rejeté pour ce qu’il désire, mais parce que toute expression de la sexualité est bannie, à Chicoutimi. Comme le dit le narrateur :
«Tout ce qui est sexuel est profondément refoulé à Chicoutimi et dans les environs» (Lambert, p. 43).
L’enfant incarne une menace plus vaste : il rappelle aux habitants ce qu’ils veulent effacer. Ce refoulement radical nourrit la logique du roman : la ville sera punie pour avoir voulu étouffer le désir lui-même.
Chez Delisle, l’homosexualité de Benoit est plus discrète mais tout aussi centrale. Sa liaison avec l’Européen, marquée par la clandestinité et l’impossibilité d’un amour vécu à ciel ouvert, le rejette une fois de plus hors de tout cadre légitime. Ni fils chez les Cyr, ni amant reconnu, il demeure étranger partout.
Wittig et la pensée straight
On peut relire ces deux romans avec Monique Wittig, qui voyait l’hétérosexualité non pas comme une simple orientation mais comme un ordre social qui organise la société. Dans cette logique, tout ce qui échappe à la norme est rejeté. Chez Lambert, Faldistoire est condamné parce qu’il n’entre pas dans la “pensée straight”, mais il retourne cette condamnation en force de frappe. Chez Delisle, Benoit vit son homosexualité dans la clandestinité : il n’y a pas de flamboyance, seulement le silence et la honte. L’un en fait une arme, l’autre disparaît sous le poids de la norme.
Noms de feu et d’effacement
Le rôle du nom est central, et les deux romans en font une clé d’interprétation.
À l’école, on doit savoir écrire son nom dès le premier jour. Ce rite apparemment banal trace une frontière décisive : être nommé, c’est appartenir. Mais pour Faldistoire, déjà marqué par un prénom grotesque, écrire son nom, c’est exhiber sa différence. Le nom devient une brûlure.
Sur le carton jaune pâle, on écrit notre nom avec de belles grosses lettres de couleur et moi je marque le mien […] F-A-L-D-I-S-T-O-I-R-E, […]. Faldistoire, on voit pas ça souvent, c’est français? (Lambert, p. 38).
Après la mort de Sylvie et le suicide de sa mère Viviane, Faldistoire devient Le-fils-de-Viviane. Le texte ne précise pas si ce nom est choisi par lui, comme revendication, ou imposé par les autres, comme insulte supplémentaire. Dans les deux cas, il agit comme une marque incandescente : rappel de la honte maternelle ou défi lancé à l’ordre patriarcal.
Chez Delisle, au contraire, le nom efface. Benoit n’est jamais maître du sien : réduit au tiroir 24, puis « gars des Cyr », il ne s’approprie rien. Même son patronyme se dissout. Et lorsque l’incendie le défigure, Cyr résonne comme cire, consumée par le feu. Ici, le nom n’est jamais retourné, il n’ouvre pas de flamboyance : il se retourne contre lui, instrument d’effacement.
Je ne suis pas un vrai Cyr. J’ai beau balayer jour et nuit, obéir au doigt et à l’oeil, me taire quand il faut, je reste d’un autre sang. (Delisle, p. 52)
Dans les deux cas, ce ne sont pas les désirs ou les singularités qui condamnent les personnages, mais l’impossibilité de correspondre aux valeurs imposées : pureté, légitimité, hétérosexualité, tradition. La littérature devient alors un espace de revanche : foudroyante chez Lambert, resserrée et tragique chez Delisle. Deux manières opposées de dire la même chose : quand une communauté érige ses valeurs en absolu, elle détruit ceux qui ne s’y plient pas.
Écriture, blessure, sujet
Chez Lambert, on retrouve quelque chose de lacanien : le Nom-du-Père, censé inscrire le sujet dans la loi symbolique, est refusé, remplacé par une filiation maternelle marginalisée. Comme l’écrivait Dolto, l’enfant ne peut se constituer qu’à travers le langage et la reconnaissance — or, Faldistoire s’arrache ce droit de nommer pour lui-même, quitte à tout incendier.
Chez Delisle, au contraire, l’enfant adopté n’accède jamais à ce moment. Le nom ne structure pas : il dissout. L’absence d’appropriation empêche l’avènement du sujet. Tout se résout dans une écriture minimaliste, glaciale, où l’on entend le silence d’un être qui n’a jamais eu la possibilité de dire « je ».
Conclusion
Kev Lambert et Michael Delisle racontent chacun, à leur manière, la même histoire : comment une société condamne ceux qui ne cadrent pas avec ses valeurs. Mais là où Lambert choisit l’éclat ravageur, baroque, halluciné, donnant aux exclus une revanche incandescente, Delisle s’en tient à la sobriété tragique, racontant l’effacement sans retour.
Deux écritures, deux tonalités, un même constat : dès que l’existence ne correspond pas aux attentes du groupe, elle est vouée à la destruction. Et dans les deux cas, c’est l’homosexualité, ce désir hors de la « pensée straight » dont parlait Wittig, qui cristallise l’exclusion et scelle le destin des personnages.
Bibliographie
Delisle, Michael, Tiroir no 24, Montréal, Boréal, 2018, 132 p.
Hamad, Anne-Marie, «Le statut du sujet dans le langage et dans la parole» dans Schauder, C. (dir.), Lire Dolto aujourd'hui, dans Actualité de la psychanalyse, Paris, Érès, 2009, p. 27-35, en ligne, < https://doi.org/10.3917/eres.schau.2008.02.>
Lambert, Kev, Tu aimeras ce que tu as tué, Montréal, Héliotrope, 2021, 216 p.
Pfauwadel, Aurélie, «“Il n’y a pas de normes sexuelles. Il n’y a que des normes sociales” Lacan réponse à Foucault» dans Genre, sexualité & société, no. 21, Printemps 2019, en ligne, <https://journals.openedition.org/gss/5489?fbclid=IwAR2MofCJCiIXLqfomN4fO_Lik9mZtXXhFx4UrT5kJNw4rcuV6zth8aXjxbI&lang=en>
Wittig, Monique, La pensée straight, Paris, Amsterdam, 2018, 153 p.