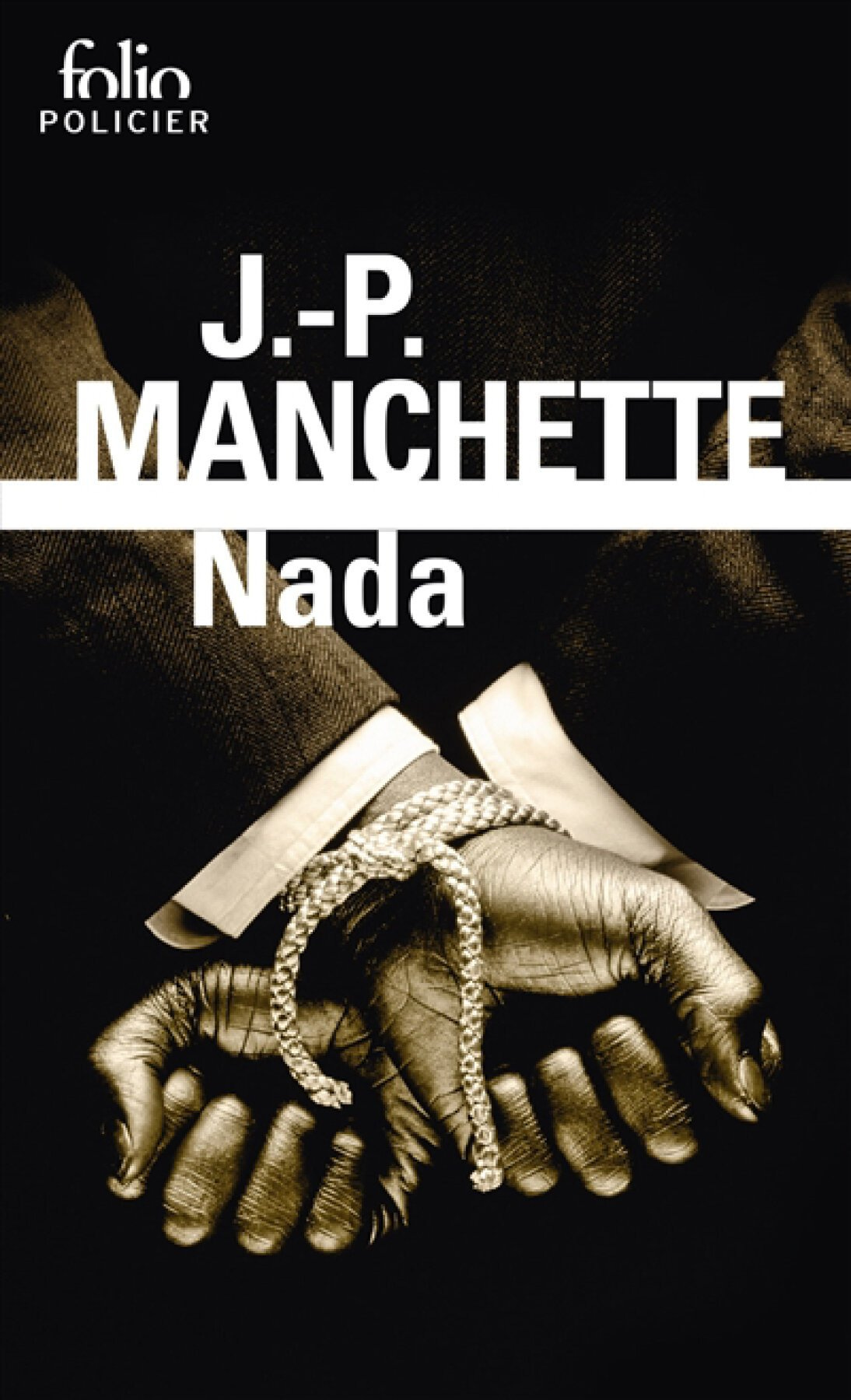Nada : quand la révolte devient spectacle
Le théâtre sanglant du rien
Une version plus académique de ce texte a été publié antérieurement sur Pop en Stock sous le titre Désengagement narratif et manipulations spectaculaires - Nada de J.P.Manchette
« Le destin n’a pas de morale », écrivait Roger Vailland dans Drôle de jeu (1957). C’est aussi le constat brutal qui traverse Nada, polar culte de Jean-Patrick Manchette paru en 1972.
Un groupe d’anarchistes enlève un diplomate américain à Paris. Ils rêvent d’action directe, de guérilla urbaine, d’un coup d’éclat révolutionnaire. Mais dès les premières pages, à travers la lettre du gendarme Poustacrouille à sa mère, on sait déjà que tout finira dans le sang, que l’État en sortira indemne et que leurs illusions s’écraseront contre le mur du réel. Alors pourquoi lire un roman dont l’issue est jouée d’avance ?
Parce que Manchette ne fait pas seulement du polar : il fait de la littérature.
Du polar de gare au roman critique
Au début des années 70, le polar français ronronnait encore autour de détectives gouailleurs et de gangsters sympathiques. Manchette casse ce moule. Son style sec, hérité du hard-boiled américain, s’imbrique à la sécheresse du Nouveau Roman. Il prend le genre le plus populaire pour en faire une arme de critique sociale. Ainsi naît le néo-noir.
Dans Nada, il n’y a pas de mystère à résoudre, pas de héros moral. Seulement des anarchistes paumés, des flics cyniques et un système qui écrase tout. Ni bons ni méchants : seulement des humains aux prises avec la vie et celle-ci se vit mal.
L’action directe comme mascarade tragique
Les membres du groupe Nada sont des ratés magnifiques : anciens résistants fatigués, profs frustrés, anarchistes par tradition familiale, alcooliques, serveurs humiliés. Une brochette de picaros en tous genres. Leur geste ressemble plus à un suicide collectif qu’à une révolution.
En face, l’État manipule, infiltre, déforme, récupère. L’enlèvement devient une mise en scène. Les médias font passer les rebelles pour des monstres. Et le commissaire Goémond, incarnation du pouvoir cynique, abat tout ce qui bouge, y compris l’otage censé être sauvé.
Tout est spectacle. Le pouvoir joue sa pièce. Les anarchistes aussi. Mais au final, le public n’y voit qu’une seule chose : l’ordre rétabli.
Engagement ou désengagement ?
On a souvent qualifié Manchette d’écrivain engagé. Mais Nada dit l’inverse : la lutte armée est inutile, la rébellion toujours récupérée. Le système gagne à la fin.
Pas de Sartre ici, pas de foi dans l’action. On est du côté de Barthes et des situationnistes : toute explication devient spectacle, tout engagement devient manipulation. Le roman est politique, mais en creux : il ne défend ni l’État ni les révolutionnaires. Il expose un monde absurde et truqué, sans proposer de solution.
C’est peut-être ça, la force paradoxale de Manchette : transformer le désengagement en forme ultime d’engagement.
Quand la politique devient reality show
C’est là que Nada résonne aujourd’hui. Cinquante ans plus tard, on nous sert le même spectacle, en version améliorée. Chaque procès, chaque meeting politique américain devient un épisode de téléréalité. On ne débat plus des faits, on commente leur mise en scène. Les caméras braquées sur Donald Trump entrant au tribunal, les punchlines calibrées pour X, les « révélations » montées en bande-annonce : la politique est devenue un reality show mondialisé.
La vérité importe peu. Ce qui compte, c’est le récit qu’on impose. L’État (ou ses rivaux) fabrique sa version des événements, et le public consomme la mise en scène.
Et pendant ce temps, certaines tragédies sont effacées. Les images du massacre palestinien circulent, mais le discours dominant les reformule en « riposte », en « droit à se défendre ». La critique d’Israël est criminalisée, le génocide se déroule sous nos yeux, travesti en nécessité sécuritaire.
Le réel est avalé par sa représentation. Mais Manchette laisse entrevoir qu’un récit survivant, transmis ailleurs, puisse un jour ouvrir une brèche dans le mensonge
Le vide plein de bruit
Rien : c’est ce que signifie Nada. Mais ce vide est dense. Plein de lucidité, de colère, d’intelligence nerveuse. Manchette ne donne pas de réponses. Il force à regarder l’impasse, la récupération permanente, la violence nue.
Et nous, lecteurs de 2025, ne pouvons que constater à quel point ce Nada résonne encore : le vide est partout, mais il continue de faire du bruit.
Bibliographie
Carron, Delphine, « Figures du détective dans le polar américain contemporain », Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Docteur de l’Université d’Angers, Études anglophones, Littérature étrangère, Université d’Angers, 2013, 305 f.
Denis, Benoit, Littérature et engagement [format EPUB], Paris, Seuil, 2000, 391 p.
Desnain, Véronique, « Style et idéologie dans le roman noir », Itinéraires [en ligne], 2015-1 | 2015, <http://journals.openedition.org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/itineraires/... >, consulté le 28 juin 2023, 13 p.
Dolto, Sophie, « Il faudrait cesser d’écrire des romans: récupération feuilletonesque du mouvement social: Jean-Patrick Manchette et la politique », a dissertation in French for the Graduate group in Romance Languages presented to the Faculties of the University of Pennsylvania in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 2023, 367 f.
Evans, Christophe, Secouer la cendre dans les olives. Une lecture socio-politique de Manchette,Bibliothèque publique d’information, Centre Pompidou, janvier 2011, p. 5, en ligne, <https://pro.bpi.fr/content/uploads/sites/3/2014/09/pdf-methodo-2001-manc...
Fondation de la Résistance, « Francs-tireurs et partisans français (FTPF) », Glossaire. Lexique de la Résistance, en ligne, <https://www.fondationresistance.org/pages/rech_doc/?p=glossaire&iIdGloss...
Frommer, Frank, « Jean-Patrick Manchette: le facteur fatal », Mouvements, 2001, N°15-16, p.89.
Gabriel, Fabrice, « Manchette, ou la fin d’une époque – à propos des Lettres du mauvais temps, Correspondance 1977-1995 », AOC, 22 juillet 2020, en ligne, < https://aoc.media/critique/2020/07/21/manchette-ou-la-fin-dune-epoque-a-... >
Manchette, Jean-Patrick, Chroniques, sous la direction de Doug Headline et François Guérif, Paris, Payot et Rivages, 1996, 384 p.
Manchette, J.-P., Nada, Paris, Gallimard, coll. « Folio Policier, N°112 », 1972, 242 p.
Martin, Christian, « Roland Barthes ou l’engagement en question », The French Review, Vol. 75, n°4 (mars 2002), p. 730-741, en ligne, < http://www.jstor.org/stable/3133302>, consulté le 20 juin 2023.
Mepian, Thoranin, « Le polar français entre 1960 et 1990 », Bulletin de l’ATPF, n° 135, année 41 (janvier- juin 2018), p. 18- 31, en ligne, <https://so01.tci- thaijo.org/index.php/bulletinatpf/article/view/139534... >
Rabaté, Dominique, « Nada, un livre sur rien ? », dans, Jean-Patrick Manchette et la raison d’écrire, dirigé par Le Flahec, Nicolas, Gilles Magniont, François Guérif et all., [format EPUB], Toulouse, Anacharsis, 2017, 292 p.
Reuter, Yves, Le roman policier 3ᵉ éd., Malakoff, Armand Colin, © 1997, 2017, 160 p.
Tadié, Benoît, Le polar américain, la modernité et le mal (1920-1960), Paris, Presses universitaires de France, 2006, 235 p.
Vailland, Roger, Drôle de jeu, Paris, Buchet- Chastel, 1957, 344 p., en ligne, <https://archive.org/details/droledejeu0000vail>