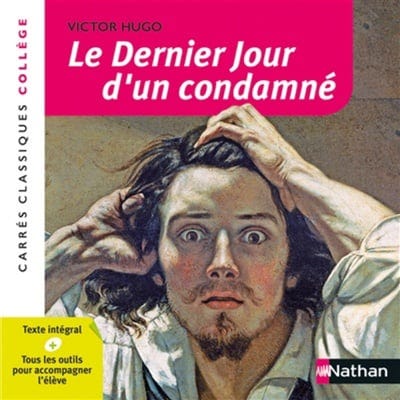Le Dernier Jour d’un condamné
Et si la vieille fiction pouvait encore troubler le réel ?
Cette publication porte sur le roman du même titre dont voici la notice biblographique:
Hugo, Victor, Le Dernier Jour d’un condamné, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », n° 6247, 2000 [éd. orig. 1829], 208 p.
J’imagine déjà les sourcils se relever… Oui, je sais. Le titre sent la poussière, le vieux papier, les bancs d’école. Un condamné à mort, vraiment ? C’est pas un peu morbide, dépassé, inutile, tout ça ?
Eh bien non. Pas si vite. Parce que pendant qu’on se croit à l’abri, peinards dans nos conforts civilisés, il y a encore des pays qui tuent légalement. Qui décapitent, électrocutent, injectent, pendouillent, à la chaîne ou presque.
Et puis il y a cette petite musique qui revient, celle d’une droite bien droite, qui ne déteste pas tant que ça l’idée de faire payer les « coupables », surtout quand ils sont pauvres, racisés, différents ou trop seuls pour se défendre. La justice expéditive a encore ses fans. Et ses promoteurs.
Alors oui, on en parle. Encore. Parce qu’un texte comme celui-là, signé Hugo, n’a pas dit son dernier mot.
Depuis longtemps, je crois fermement que la littérature peut changer quelque chose. Peut-être pas la manière dont le monde tourne, mais elle a, pour moi le pouvoir singulier d’éveiller les consciences, de reconnaître les silences, de croiser des regards, de nous mener un peu plus loin. En relisant Le Dernier Jour d’un condamné, cette certitude s’est ravivée. Ce texte n’appartient pas au passé. Il parle, encore. J’ai aujourd’hui envie de partager ici quelques réflexions sur cette œuvre admirable, toujours actuelle.
Quand j’ai relu ce titre, je croyais en connaître l’histoire. Je l’avais lu autrefois, mais avec les yeux encore clos de celle qui n’était pas habituée à l’analyse littéraire. Victor Hugo, un plaidoyer contre la peine de mort, un roman célèbre… Voilà ce que je croyais retrouver. Mais cette fois, avec les outils acquis, je suis allée plus loin. Et je ne m’attendais pas à ce que j’ai trouvé.
Ce n’est pas qu’un roman, au fond. C’est une voix. Une voix qui parle dans le noir, enfermée, terrifiée. Une voix qui sait qu’elle va mourir.
« Condamné à mort ! Voilà cinq semaines que j’habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids ! » (p.23)
Hugo, en 1829, choisit une forme peu commune : celle du journal intime fictif. Ce serait même, selon certains, la première fois qu’un auteur adopte ce format en littérature. Il fait parler un condamné à mort, sans nom, sans identité. Juste un « je » universel, brut, sans défense. Et à travers ce “je”, c’est à nous tous qu’il s’adresse, mais c’est aussi à nous tous qu’il donne voix.
Contexte : une France en débat
En 1827, deux ans avant la publication du Dernier Jour d’un condamné, des concours sont organisés par la Société de morale chrétienne pour récompenser les meilleurs essais en faveur de l’abolition de la peine de mort. Des textes juridiques, philosophiques, rationnels sont soumis. Le premier prix est attribué à Charles Lucas, avocat à la Cour Royale de Paris, dont le plaidoyer abolitionniste est largement diffusé. Hugo ne participe pas à ces concours. Il ne cherche pas à convaincre par des arguments, ni à rivaliser avec les penseurs du droit.
Mais il lit. Il observe. Il écoute. Et ce qu’il propose ensuite, c’est tout autre chose.
Plutôt qu’un discours bien construit, il offre une expérience. Une voix. Un journal fictif, sans explication ni démonstration, mais habité d’angoisse, de solitude, d’humanité nue. Là où les autres argumentent, Hugo fait ressentir. Il ne veut pas remporter un prix: il veut éveiller une conscience. Peut-être même la vôtre.
L’intuition géniale : un journal fictif
Ce choix, c’est vraiment un coup de génie littéraire. Plutôt que de servir des arguments juridiques ou philosophiques, Hugo parie sur l’émotion. Il emprunte au genre du journal intime cette impression de vérité brute : la sincérité du désespoir, les pensées de la dernière heure, les détails sensoriels d’un corps qui attend la mort.
Certaines sources mentionnent qu’il aurait lu, dans Le Globe, un Journal de Viterbi, prétendument tenu par un condamné à mort britannique revenu à la vie. D’autres affirment qu’il s’est inspiré des Mémoires de Vidocq, ce bagnard devenu chef de police. Peu importe. Ce qu’il en fait, lui, dépasse ses prétendus modèles. Il transforme la matière brute en œuvre littéraire. Il nous tend un miroir noir, dans lequel on est forcé de se regarder.
En refusant de nommer son personnage, en le dépouillant de toute identité, Hugo universalise son sort. Le condamné, c’est n’importe qui. Et c’est précisément ce flou qui nous piège : le condamné, c’est toi, c’est moi, c’est chacun d’entre nous.
Une voix sans lecteur — mais pour nous tous
Ce qui bouleverse, c’est que ce journal n’a pas de destinataire. Le condamné écrit pour lui-même, peut-être pour personne. Il parle dans le vide, ou à l’après. Il tente de se donner du courage, regrette les bonheurs terrestres perdus.
Et c’est là que le lecteur devient l’héritier d’une parole qui ne devait pas être entendue. Un témoin malgré lui.
Cette parole solitaire, fragmentée, incertaine, devient une arme littéraire. En nous forçant à habiter la tête de ce condamné, Hugo trouble notre confort. Il ne nous montre pas la guillotine, il nous fait sentir son ombre. Il ne raconte pas un crime, il raconte l’attente. Le silence. L’angoisse. Et une fois qu’on l’a entendu, on ne peut plus faire comme si de rien n’était. C’est là, et ça nous concerne.
Entre document et fiction : l’ambiguïté comme stratégie
Quand Le Dernier Jour d’un condamné paraît, Hugo ne signe pas. Il ne revendique rien. Il laisse croire à un journal abandonné, retrouvé, réel. Il efface l’auteur pour mieux faire entendre la voix du condamné. Pas de nom, pas de cadre. Juste cette parole, lancée dans le vide. C’est un texte sans origine apparente , et c’est précisément ce qui le rend si saisissant.
Tout ceci est volontaire. Ce n’est pas une fiction affichée, c’est une illusion de réel, un piège tendu à la sensibilité du lecteur. Un dispositif d’immersion, qui donne l’impression d’un témoignage brut, intime — qui ne nous est pas destiné, que nous n’avions pas le droit de lire, ce qui le rend d’autant plus vrai.
Le mélange d’éléments réels et imaginaires démontre une double volonté de transmission et un double effort de persuasion. Les pensées du condamné nous parviennent de façon fragmentaire — un effet lié à la forme même du journal intime, bien avant que le fragment ne devienne un procédé littéraire à la mode et en raison de la nature même du genre. Ce “Je” non identifié, innommé, place déjà le lecteur à l’intérieur, à l’endroit même où l’auteur se trouve, à une profondeur où rien ne subsiste des repères avec lesquels sont construits les personnages.
Et puis, brusquement, Hugo se montre.
Trois ans plus tard, dans une préface fracassante, il signe, il affirme, il nomme. Ce texte est le sien, et il n’a qu’un but : dénoncer la peine de mort. Plus de doute, plus de cachette, plus de détour.
Ce basculement change tout. L’anonymat donnait au texte une dimension universelle, presque documentaire. On lisait une vie, pas une œuvre. Mais désormais, ce que l’on croyait être une plainte devient un manifeste. Ce n’est plus une voix perdue, c’est une voix d’auteur. Un acte politique. Un roman puissant.
Le Dernier Jour d’un condamné nous met devant une hybridité multiple, d’abord celle de la rencontre d’un genre fictionnel (le roman) et d’un genre factuel (le journal intime) puis par le mélange du genre littéraire avec l’expression de l’engagement politique de l’auteur, la critique du système judiciaire de son époque, démontrant ainsi la perméabilité des genres et des idées.
Aujourd’hui : que reste-t-il à entendre ?
Le Canada a aboli la peine de mort en 1976, la France en 1981, plus de 150 ans après la publication du texte. Mais ailleurs, elle demeure. Aux États-Unis, 27 États conservent encore ce châtiment. Chaque année, des exécutions ont lieu. Des innocents sont parfois découverts, trop tard. Et la justice, comme souvent, frappe plus durement les plus pauvres, les plus racisés, les plus isolés.
Ce que Victor Hugo dénonçait n’a pas disparu. Ça a simplement changé de visage.
Dans le contexte nord-américain, le journal du condamné prend une autre résonance. Il pourrait s’appeler Malik, Javier ou Tyrone. Être noir, autochtone ou latino. Il pourrait aussi s’appeler Sky, Alex ou Misha. Être trans, homosexuel, sans abri. Avoir grandi dans un quartier oublié, être défendu par un avocat surchargé, être condamné par un jury biaisé. Et finir seul, dans le couloir de la mort ou en marge du monde, à écrire dans sa tête ce que personne ne lira.
Et si on écrivait aujourd’hui un “dernier jour” ?
La question posée par Hugo est toujours là, suspendue : avons-nous le droit de tuer au nom de la justice ?
Ce “je” solitaire qu’il a créé pour troubler les consciences continue de nous parler parce que nous avons encore besoin d’entendre des voix que certains veulent faire taire.
Aujourd’hui encore, des récits surgissent des interstices, portés par ceux qu’on n’écoute pas : racisés, pauvres, queer, incarcérés. À travers eux, c’est la même exigence : voyez-moi. Écoutez-moi. Ayez conscience de l’horreur imposée, même à ceux qui ont fauté, car aucun crime, aussi grave soit-il, ne justifie qu’on éteigne une vie.
La littérature, disait Hugo, n’est pas là pour fuir le réel, mais pour y ajouter quelque chose. Ce “plus” fragile, tremblant, qui fait vaciller l’indifférence.
Pour aller plus loin
Pourquoi ne pas (re)lire Hugo aujourd’hui ? Non pour le passé, mais pour ce qu’il dit encore du présent…
Voici, de plus, quelques œuvres marquantes à lire, voir, ou pour y réfléchir
En fiction
Camus, Albert, Réflexions sur la guillotine, suivi de Lettres à un ami allemand, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2009 [1re éd. 1957], 128 p.
King, Stephen, La ligne verte, Paris, J’ai lu, 1999, 508 p.
Mailer, Norman, Le chant du bourreau, Paris, Lafond, 1980, 880 p.
Prejean, Helen, La mort des innocents : un témoignage oculaire sur les exécutions arbitraires, Paris, Buchet-Chastel, 2007, 349 p.
Stevenson, Bryan, Just Mercy: A Story of Justice and Redemption, New York, Spiegel & Grau, 2014, 352 p.
Essais, articles et documents théoriques
Assemblée Nationale (France), Loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, en ligne, https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/siecles_debats.asp
Auger, Manon, « Le cas du journal fictif. L’hybride romanesque comme phénomène dynamique intergénérique », Québec français, n° 138, été 2005, p. 34-38.
Bowman, Frank, « L’intertextualité du Dernier Jour d’un condamné », dans Victor Hugo, Romancier de l’Abime : New Studies on Hugo’s Novels, [format ePub], Londres, Routledge, 2002, 2017, p. 41-61.
Carbasse, Jean-Marie, « Chapitre IV. La peine de mort aux XIXe et XXe siècles », dans La peine de mort, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 2016, p. 84-105.
Charlier, Gustave, « Comment fut écrit Le Dernier Jour d’un condamné », Revue d’Histoire littéraire de la France, 22e Année, n° 3/4 (1915), en ligne, https://www.jstor.org/stable/40517962, consulté le 2 février 2023, p. 321-360.
Denis, Benoît, « Chapitre X. Hugo. La poésie et la tribune », dans Littérature et engagement, de Pascal à Sartre, Paris, Seuil, coll. « Points Essais, Série Lettres », 2000, p. 179-205.
École Nationale d’Administration Pénitentiaire / Histoire, Biographie de Charles Lucas (1803 — 1889), en ligne, https://www.enap.justice.fr/sites/default/files/upload/parcours_5_charles_lucas_biographie.pdf
Oura, Yasusuke, « Roman journal et mise en scène “éditoriale” », Poétique, n° 69, 1987, p. 5-20.
Sapiro, Gisèle, « Chapitre 3. Des écrivains justiciers aux écrivains prophètes », dans La responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (XIXe–XXIe siècle), Paris, Seuil, 2011, p. 144-172.
Film
La Dernière Marche (Dead Man Walking), film réalisé par Tim Robbins, avec Susan Sarandon et Sean Penn, États-Unis, Polygram Filmed Entertainment, 1995, 122 min.