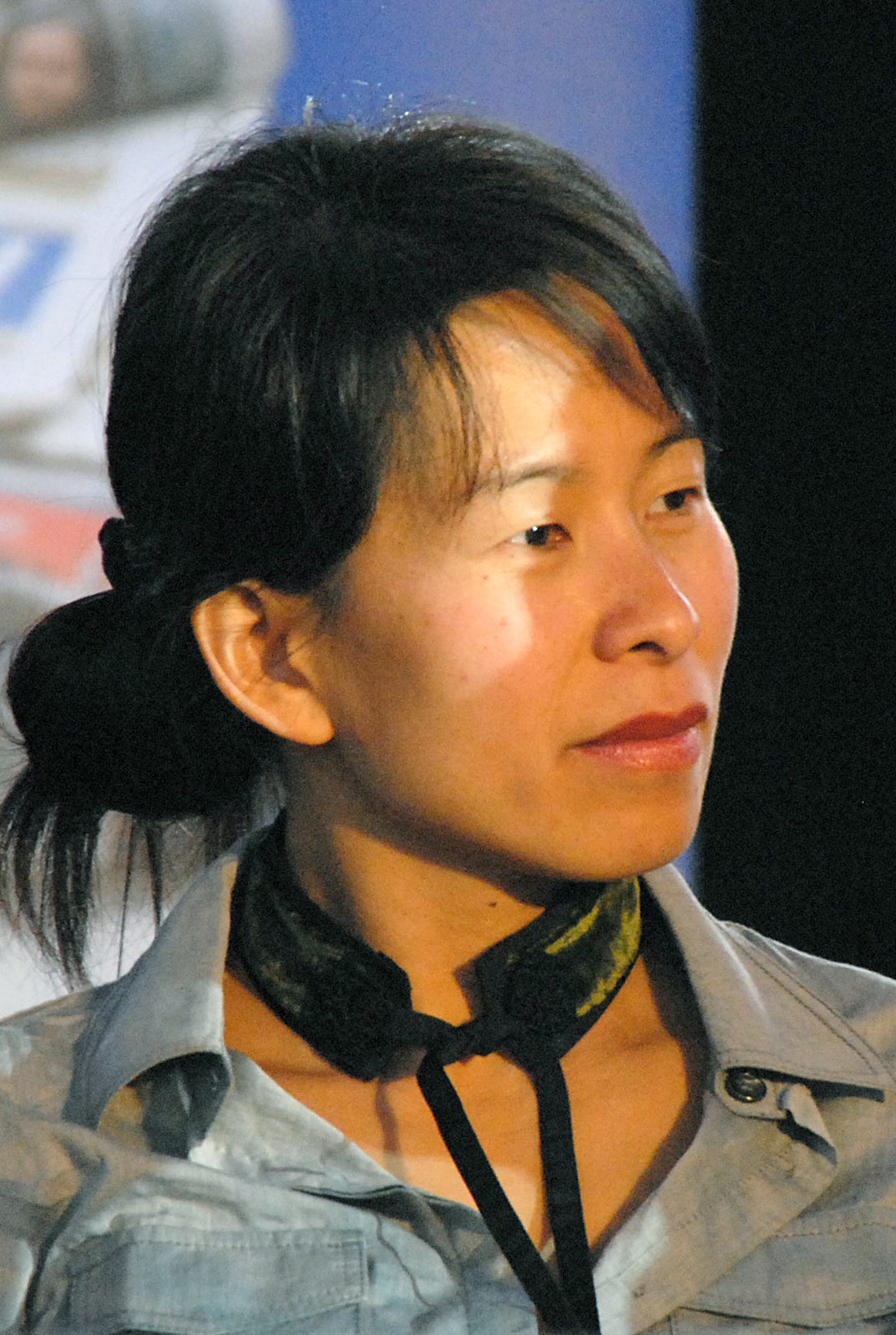La part manquante
Tant que les blessures de l’exclusion persistent, le Québec nie une part de lui-même.
Quand Kim Thúy, l’immigrante modèle par excellence, confie sa « peine d’amour » envers le Québec, elle ravive la mémoire de son arrivée en 1979, au terme d’un exil marqué par l’épuisement et la survie. Elle rappelle qu’un pays qui fut refuge peut aussi devenir source de désillusion, à mesure que l’accueil se transforme en méfiance. Cette blessure intime rejoint, par un autre chemin, la voix de Marco Micone dans Speak What (1989), poème qui portait déjà la demande des immigrants d’être entendus dans leur pluralité, en déplaçant les interpellations de Speak White (Michèle Lalonde, 1968), alors que le Québec cherchait encore sa voie, pour leur donner une portée migrante. Entre la confidence douloureuse d’une écrivaine et la parole collective d’un poète, une même question demeure : comment le Québec peut-il rester fidèle à lui-même s’il se ferme à ceux qui le choisissent?
« Speak What » de Marco Micone (1989)
Il est si beau de vous entendre parler
de La Romance du vin
et de L'homme rapaillé
d'imaginer vos coureurs des bois
des poèmes dans leurs carquois
nous sommes cent peuples venu de loin
partager vos rêves et vos
hivers nous avions les mots
de Montale et de Neruda
le souffle de l'Oural
le rythme des haïkus
speak what now
nos parents ne comprennent déjà plus nos enfants
nous sommes étrangers
à la colère de Félix
et au spleen de Nelligan
parlez-nous de votre charte
de la beauté vermeille de vos automnes
du funeste octobre
et aussi du Noblet
nous sommes sensibles
aux pas cadencés
aux esprits cadenassés
speak what
comment parlez-vous
dans vos salons huppés
vous souvenez-vous du vacarme des usines
and of the voice des contremaîtres
you sound like them more and more
speak what que personne ne vous comprend
ni à Saint-Henri ni à Montréal-Nord
nous y parlons
la langue du silence
et de l'impuissance
speak what
« productions, profits et pourcentages »
parlez-nous d'autres choses
des enfants que nous aurons ensemble
du jardin que nous leur ferons
délestez-vous des maîtres et du cilice
imposez-nous votre langue
nous vous raconterons
la guerre, la torture et la misère
nous dirons notre trépas avec vos mots
pour que vous ne mouriez pas
et vous parlerons
avec notre verbe bâtard
et nos accents fêlés
du Cambodge et du Salvador
du Chili et de la Roumanie
de la Molise et du Péloponnèse
jusqu'à notre dernier regard
speak what
nous sommes cent peuples venus de loin
pour vous dire que vous n'êtes pas seuls.
Les mots de Kim Thúy et le poème de Marco Micone, séparés par une génération, disent en réalité la même chose : l’appartenance au Québec n’est jamais acquise une fois pour toutes, elle se rejoue dans chaque regard porté sur l’Autre. Derrière la fatigue de l’exil comme derrière la lucidité du poème, on retrouve une exigence commune : que le Québec demeure une terre capable d’écouter et de se transformer avec celles et ceux qui l’habitent.
Notre jeunesse souffre aussi de ces attitudes de mise à l’écart. Les « tu viens d’où » et « retourne chez vous » creusent des blessures qui les déracinent dans leur propre terre, eux qui n’ont connu d’autre origine que le Québec.
Kim Thúy, Marco Micone, Jenny Salgado : trois voix émettent une même vérité: tant que ces blessures demeurent, le Québec se prive d’une part de lui-même.